

Dans ce remarquable ouvrage, David Rothenberg s’est penché sur cet oiseau emblématique des nuits printanières, à la fois sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan scientifique.
Pourquoi a-t-il éprouvé le besoin de réunir des humains et des rossignols pour faire une musique interespèces ? Le premier élément de réponse qu’il apporte est que cela permet de «créer quelque chose qu’aucune espèce ne pourrait faire seule». Il pose ici de nombreuses questions et cherche avec l’aide de scientifiques, chercheurs, bioacousticiens de renom à savoir notamment si nous pouvons mesurer la beauté d’un chant d’oiseau et en particulier celui du rossignol ?
Pour aller plus en profondeur, il cherche également avec l’aide de biologistes comme Richard Prum à savoir en quoi « l’évolution de la musique du rossignol s’inscrit-elle dans un monde artistique ? ». Une autre énigme apparaît logiquement : « Les rossignols aiment-ils jouer leur musique avec des humains ? ».
Mais il ne fait pas qu’interroger les scientifiques, David Rothenberg cherche aussi à leur apporter des réponses pour justifier «l’idée que la nature et l’humanité puissent cohabiter.» Au-delà des sons produits, du chant émis par les oiseaux, il cherche à comprendre en quoi «un chant s’harmonise avec le lieu où il est chanté» et s’intéresse ainsi à son paysage sonore. Il nous emmène dans des domaines que nous sommes loin d’imaginer par exemple, en nous faisant découvrir un mystérieux «effet Sharawadji» par l’intermédiaire d’un spécialiste des grillons Lars Fredriksson, et qui pourrait se définir par «la beauté de l’irrégularité recherchée». Tout aussi étrange, on apprend ici que les mâles rossignols émettent un étrange son, le son «boori», et dont la chercheuse Silke Kipper démontre que «les femelles rossignols aiment ce bourdonnement bien plus que n’importe quelle autre sonorité chantée à tue-tête par les mâles. ». Mais à la question de savoir si ce son est moche, son ami le musicien expérimental Korhan Erel répond « ce ne sont que des concepts humains… cet oiseau a plus de matière à nous offrir que ce nous lui apportons ».
Comment savoir si jouer de la musique avec eux influence réellement cette espèce ? Citant John Keats, « Beauté, c’est Vérité. Vérité, c’est Beauté ». La beauté n’est pas un critère scientifique, mais alors comment l’évaluer ? En quoi les préférences des femelles rossignols sur le plan esthétique sont-elles déterminantes pour la survie de l’espèce ? Tina Roeske en conclue que ces oiseaux ont du Swing et que « l’aspect le plus mesurable de la musicalité du Nachtigall repose sur le rythme et non sur la structure ou la forme. »
Pour David Rothenberg les rossignols seraient les «Thelonious Monk dans le monde du chant aviaire» car il nous surprend et nous surprendra toujours. Une autre révélation est que les silences qui marquent chaque séquence d’un chant de rossignols sont tout aussi déterminants que les claquements, bourdonnements, sifflements de son chant. Ainsi Ofer Tchernichovski sur la base de milliers de phrases individuelles de chants de rossignols enregistrés dans toute l’Europe, a pu en faire une représentation graphique révélatrice.
Mieux encore, David cherche à comprendre comment les sons aviaires s’assemblent pour former un ensemble acoustique dans un paysage sonore ? Il cherche à encourager l’écoute active ou de percevoir « l’ancrage de cet ensemble » dans le monde réel. « Comment savoir si un paysage sonore est meilleur qu’un autre ? ». Il reprend ici « l’hypothèse de la niche » de Bernie Krause, hypothèse selon laquelle chaque oiseau produit des sons dont la fréquence lui est propre et qui permet de l’identifier en tant qu’individu.
Seriez-vous la différence entre un Rossignol philomèle ou un Rossignol progné ? Dans sa quête de beauté, il a écouté le « plus beau son de nature» pour comprendre ce qui en fait la perfection.
Mais au-delà de toutes ses interrogations, il conclut que si nous voulons «estimer à sa juste valeur la musique de l’oiseau, nous devons nous plonger dans son propre sens esthétique. Si nous voulons participer à sa musique, nous ne pouvons pas l’imiter, mais devons apprendre de lui en apportant notre propre humanité à cette relation.»
Quel est le but recherché par David lorsqu’il fait de la musique avec d’autres espèces animales comme les baleines, les insectes ou les oiseaux ? Sa réponse évidente est parce qu’il nous permet de « contribuer aux merveilleux sons du monde et simplement les apprécier » (p.136), en étant convaincu qu’il est de rendre les gens meilleurs et de contribuer à mieux aimer ce qui nous entoure.
Bien sûr, on ne peut s’intéresser aux sons, à la musique sans s’interroger sur ce qu’est le silence. Est-ce « l’absence de son ? », il le voit davantage comme un « instant de profonde réflexion », « un espace mental ». Mais « jusqu’où faut-il aller dans la connaissance d’un son pour le comprendre? ». Il explique « qu’écouter de la musique est une activité acousmatique, et que c’est à nous de choisir que ce nous écoutons est de la musique, mais qu’avant d’être ou d’avoir été de la musique », un « son reste un son ».
David avoue que ce qu’il attend de la musique c’est de pouvoir s’y réfugier, il recherche des lieux exempts de bruits, qui lui permet simplement d’exister. Ici, il en vient au sujet principal de son livre : « qu’est-ce qui pourrait vous inciter à tourner la page de cette quête confuse ? La recherche. La recherche du son parfait et de l’attention parfaite nécessaire pour la trouver. » Et le rossignol dans tout cela ? « le chant de cet oiseau est inexorable et particulièrement bizarre » et « dont la finalité est de chanter, tout simplement ».
Dans les « 11 voix vers la musique animale » il cherche à convaincre ceux qui voudraient jouer de la musique avec les oiseaux.
Il n’oublie pas la poésie, la littérature pour célébrer cet oiseau à travers des citations de Hafez de Chiraz, Saadi, Richard Mabey, Oliver Pike, Rosa Luxemburg, John Berger, Samuel Taylor Coleridge, John Clare, Percy Bysshe Shelley, Shakespear, William Stanley Mervin, John Keats, Goethe, John Muir, Kant… et nous convie à participer à cette musique, à vibrer au chant du rossignol, d’ouvrir nos sens et notre âme dans une véritable écoute. Et de finir par ces deux vers qu’il nous offre en conclusion de sa quête :
« Rossignol
Ton chant nous survivra à tous »

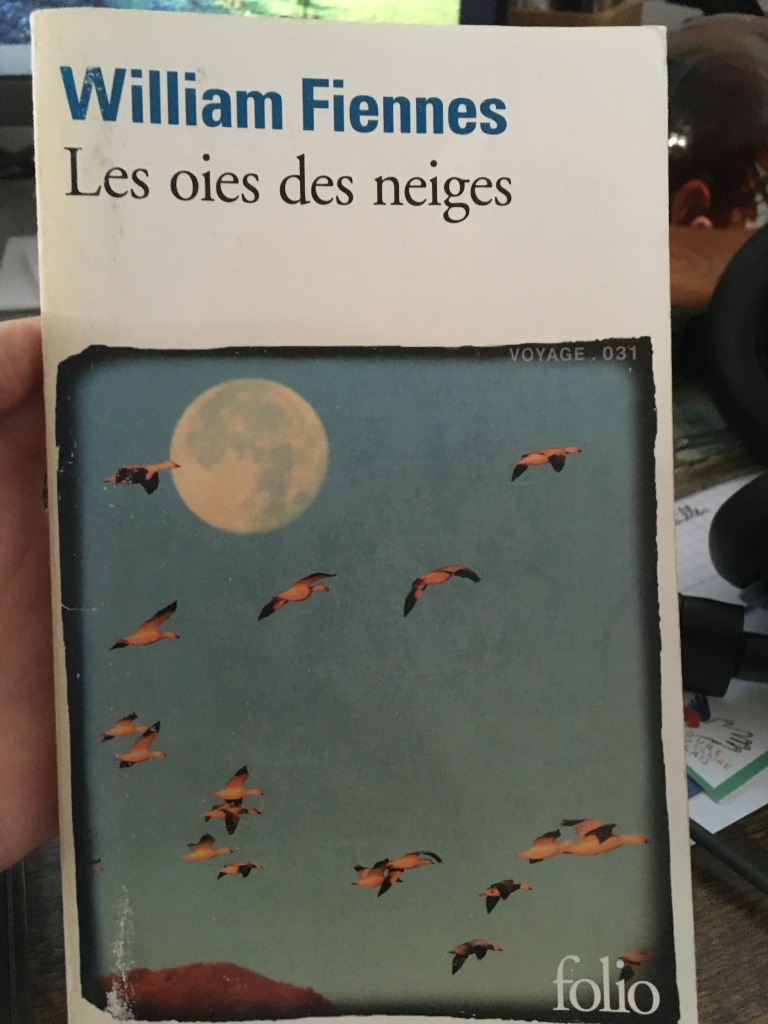
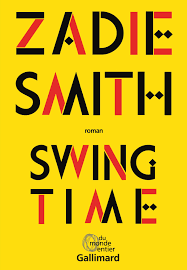 du livre relativement déçue.
du livre relativement déçue.